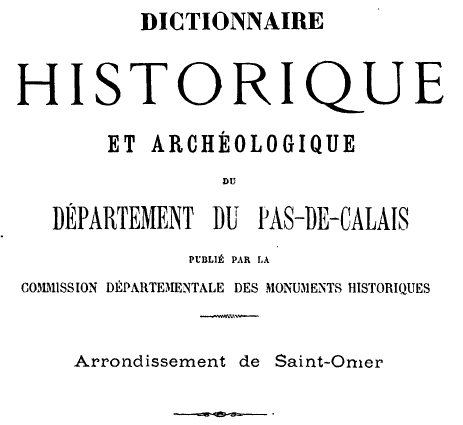Au cours des siècles, les documents nous ont conservé, différentes formes de ce nom : Au XII° siècle, en 1119 Blandeca, en 1139 Blandeka, en 1194 Blindeca, en 1197 Blendeca. Au XIII° siècle : Blindeka, Blendeke, Blendecqua, Blandecque. Au XIV° siècle : Blandesque, Blendecque, Blendecha..
L’origine, où la version la plus ancienne est la forme germanisée de Blandiacus, ou gallo-romain de « villa de Blandus », du nom du chef local, après la conquête romaine.
Le territoire de Blendecques, n’avait pas attendu cette époque pour être habité. De nombreuses trouvailles, malgré le peu de recherches par fouilles, nous donnent la certitude absolue.
En 1956, on découvrit au « Mont de Sarra » des silex taillés, avec des os de mammouth et de cerf, ce qui permet d’affirmer que le coteau Nord était habité par l’homme préhistorique, il y à 100.000 ans. Des haches polies trouvées, nous ramènent à 4.000 ans avant notre ère.
Dans la vallée, en 1839, au cours de travaux exécutés au vieux moulin, on découvrit une tombe gallo-romaine, qui se présentait sous la forme d’une petite fosse carrelée de céramiques rouges et contenant une urne funéraire, datant du 1° ou II° siècle, sa position nous permet de penser qu’a l’époque le largeur de l’Aa devait être d’environ soixante mètres, et plus vers la moitié du IV° siècle, pour redescendre vers le VII° ou VIII° siècle.
Sur le coteau Sud, au hameau de Soyecques, connu sous le nom de « Soriek » à l’époque gallo-romaine, ont été retrouvés un mélange des civilisations romaine et franque : vases, cruche en verre, épingles gravées, colliers. En 1852, au lieudit le « Fort-Mahon » des excavations contenant des vases, des épées, haches, agrafes d’or, perles de verre ou d’ambre. Vers 1951, fut découvert dans une carrière de Blendecques une statuette égyptienne, il s’agit là d’une offrande funéraire, du second siècle.
Le territoire de Blendecques, environ 952 hectares, traversé d’Ouest en Est par le fleuve côtier l’Aa, qui prend sa source à Bourthes. Le milieu du cours d’eau depuis la « Garenne », jusqu’au « Mont aux bans » servait de limite entre la châtellenie de St.Omer sur la rive gauche, et de celle d’Aire sur la Lys sur la rive droite. Ce territoire était constitué de nombreux fiefs, ou petites seigneuries, exemple : Audenfort, le Balin, Bilques, Blancbourg, Blanc chevalier, Bleu chevalier, Bresmercch, Briard, Brouay, La carrière, Le choquel, Clus, Ermitage, Fernagu, Helfaut, La rue, Soyecques, Stabon, Tailfer, Vigries, Vinders, Westove, Wintrefeld…..
L’organisation féodale :
Les châtellenies furent confiées tout d’abord à des officiers royaux, « des fonctionnaires », puis ces charges devinrent héréditaires, en 877 (sous Charles le Chauve), ce qui assurait pour ces titulaires l’intégrité, la continuité, et même une certaine indépendance. Le peuple « malgré certaines légendes républicaines » trouvait en eux des défenseurs et des appuis. Après la guerre de 100 ans, pour rendre plus efficace la défense des intérêts des villages, et faciliter le travail des administrations, un mouvement de décentralisation s’opéra (déjà). En 1383 Louis de Willerval est seigneur de Bientques, Helfaut et Blendecques. En 1398, Pierre de Montberteau achète au précèdent les trois seigneuries, qui passeront en 1404 à Pierre de Poix, « dit Baudrain » chevalier. En 1416, ce dernier, détache de sa seigneurie de Bientques, celle de Blendecques, qu’il cède au sieur Percheval d’Azincourt. En 1505, Christophe d’Azincourt et Jeanne de Poix vendent à Louis de Rebecques de Lens, la seigneurie de Blendecques. En 1628, Robert de Lens, reçoit la Sénéchaussée de Blendecques, il possédait en outre le fief du Bleu chevalier, celui du Brouay, et le fief des jardins de Soyecques. Toutefois cette famille, ne fut jamais reconnu comme ‘seigneurs de Blendecques’ malgré de nombreux procès, avec les Abbesses de Ste-Colombe, qui resteront jusqu’à la révolution, les ‘Dames de Blendecques’, pour la bonne raison qu’elles étaient propriétaires du terrain de l’église de Blendecques. En 1669, en faveur de François Joseph de Lens, le roi érigea en comté la terre et sénéchaussée de Blendecques, le titre de Comte de Blendecques fut transmit jusqu’en 1773, date de décès en son château d’Hallines, du dernier de Lens. Mathieu de Sebourg, devint Comte et Sénéchal de Blendecques, à cause de son épouse nièce du dernier Comte et Sénéchal de la famille de Lens. Le nom de Desebour, figure dans la liste des émigrés de Saint-Omer, publiée le 4 octobre 1792.
Le patrimoine :
L’abbaye cistercienne Sainte-Colombe de Blendecques, établie en 1186, elle fut vendue comme bien national en 1793, seul le porche d’entrée et le quartier abbatial tous deux reconstruit vers 1640, ainsi que la ferme construite vers 1770, existent encore, toute la partie du couvent et la chapelle, servirent de matériau de construction après leurs démolitions par les spéculateurs de l’époque révolutionnaire.
Les châteaux féodaux :
Le château du Blancbourg, construit au XII°, fut assiégé, pris et dévasté par les français en 1595, en même temps que le château de Longastre à Heuringhem. Le 16 mars 1604, Jeanne de Rummel, propriétaire semble avoir épousé en secondes noces Philippe de Lilleville sieur de Comerelle En 1610 Jacques de la Becque est seigneur du Blancbourg, puis le fief passe à sa fille Mme de Boncourt, et ensuite (sans doute par vente) dans la famille des barons de Wintrefeld. Le 24 avril 1713 Messire Ernest de Wintrefeld, prestre chanoine de la cathédrale de Gand, vend le château à Gilles Marcotte, seigneur de Roquetoire. Celui-ci lèguera le château à sa fille, épouse du sieur Bodin. Probablement disparu vers 1750/1760.
Le château de Montrayant (dit d’Helfaut), construit probablement à la même époque que le précédent. En 1776 la seigneurie fut vendue par la Comtesse Mérode, princesse de Rubempré à Messire Pierre Sandelin, comte de Fruges. La cense est occupée par Marie Jacqueline Françoise Pacou. La dernière héritière du nom Marie Olympe de Sandelin et son époux le baron Colbert-Caste-Hill, (ils habitaient, dans leur hôtel particulier, à St.Omer, aujourd’hui musée Sandelin), Ils furent inhumé à l’ancien cimetière de Blendecques en 1879 et 1882, près de la nef Sud de la nouvelle église).
D’autres châteaux : Au cours du XVIII°, XIX°, et début XX° siècle, de nombreux châteaux seront construits dans cette vallée boisée, et parcouru par l’Aa.